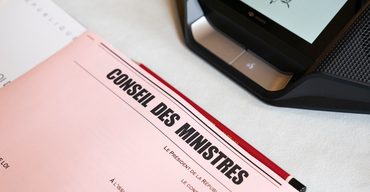PROJET DE LOI
- Accord entre la France et Chypre sur la coopération lors d’opérations d’évacuation de la région du Moyen-Orient par le territoire de Chypre dans le cadre d’une situation de crise
COMMUNICATIONS
- La mobilisation des fonds européens
- Bilan du permis de conduire à 17 ans
MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL
Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 13 février 2025 :
13 février 2025
Compte rendu du Conseil des ministres du 13 février 2025.
PROJET DE LOI
ACCORD ENTRE LA FRANCE ET CHYPRE SUR LA COOPERATION LORS D’OPERATIONS D’EVACUATION DE LA REGION DU MOYEN-ORIENT PAR LE TERRITOIRE DE CHYPRE DANS LE CADRE D’UNE SITUATION DE CRISE
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d’évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d’une situation de crise.
Signé à Paris le 9 septembre 2022 par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères et par le ministre des affaires étrangères chypriote, cet accord vise à permettre aux forces armées françaises de bénéficier d’un cadre juridique solide en cas de déploiement d’une opération d’évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre.
L’accord détermine notamment le statut des forces françaises participant aux opérations d’évacuation, accorde un certain nombre de facilités à celles-ci et fixe les conditions préalables dans lesquelles l’autorisation d’agir sur le territoire chypriote est délivrée. Cet engagement entre la France et la République de Chypre est indispensable pour sécuriser l’action des forces françaises dans le cadre d’opérations d’évacuation de ressortissants depuis des territoires en situation de crise.
COMMUNICATIONS
LA MOBILISATION DES FONDS EUROPEENS
Le Premier ministre a présenté une communication relative à la mobilisation des fonds européens.
Alors que la Commission européenne devrait présenter au cours de l’été ses propositions pour le prochain cadre financier pluriannuel (période 2028-2034), le Premier ministre a souligné l’importance des fonds européens pour l’Europe et pour la France ainsi que la nécessité de s’investir pleinement pour mobiliser davantage encore ces fonds au service des Français.
1/ De nombreux financements européens sont mobilisés en France et irriguent toutes les politiques publiques
A titre d’exemple, grâce à la politique agricole commune, nos agriculteurs reçoivent chaque année 9 milliards d’euros qui soutiennent directement leur activité et contribuent ainsi à assurer à notre pays son indispensable souveraineté alimentaire.
Grâce aux fonds de la politique de cohésion, gérés en très grande partie par les régions depuis la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, nos territoires, y compris d’outre-mer, bénéficient d’un soutien financier en faveur de leur développement économique (projets d’innovation créateurs d’emploi ; réseaux à très haut débit ; projets d’infrastructures) et de leur développement social (formations des demandeurs d’emploi ; insertion des personnes en difficulté ; rénovation thermique des logements sociaux ; aide alimentaire notamment au service des Restos du coeur).
Grâce aux fonds européens, le cinéma français bénéficie de davantage de moyens pour porter notre culture sur la scène internationale. C’est aussi le cas de la recherche française qui bénéficie de moyens additionnels dans des domaines comme la santé, le numérique (dont l’intelligence artificielle), l’énergie ou l’espace. Les fonds européens concourent également à notre effort de défense, notamment en matière de recherche et de développement industriel. Enfin, chaque année des millions de jeunes Européens (étudiants comme apprentis) peuvent connaître une expérience de mobilité européenne grâce au fonds Erasmus+.
S’y ajoutent d’autres financements européens mobilisables pour accentuer le potentiel de croissance de notre économie, tout en accélérant les transitions verte et numérique pour améliorer la vie quotidienne des Français. C’est le cas notamment des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui jouent un rôle déterminant pour le développement de nos entreprises, de nos transports en commun, de notre indépendance énergétique afin de maintenir des prix abordables pour les ménages, etc. La France fait partie des tout premiers bénéficiaires des prêts de la BEI avec plus de 12 milliards d’euros de financements. Les fonds mobilisés dans le cadre du plan de relance européen, lancé en juillet 2020, peuvent également être mis en évidence, avec 30 milliards d’euros déjà perçus sur les 40 milliards d’euros prévus pour la France.
2/ Pour autant, la stratégie de mobilisation de ces financements doit être consolidée et accentuée pour amplifier ces résultats
Plusieurs raisons motivent cette approche :
- la France est un des contributeurs majeurs au budget de l’Union européenne. Elle finance 17 % du budget de l’Union européenne, se situant ainsi en 2ème position après l’Allemagne ;
- dans le contexte actuel de finances publiques très contraintes, il est impératif de rechercher un plus grand bénéfice encore des fonds européens pour l’ensemble des Françaises et des Français. Ancrer ce « reflexe Europe » sera doublement vertueux pour nos finances publiques : maximiser notre taux de retour, tout en limitant les risques de doublons avec certaines dépenses financées au niveau national ;
- les fonds européens bien utilisés constituent des leviers puissants pour renforcer notre compétitivité, ce qui est essentiel dans le contexte de concurrence exacerbée que l’on observe sur la scène internationale ;
Le bénéfice de l’Europe pour nos concitoyens ne saurait bien sûr se résumer à une approche purement budgétaire. En effet, à l’heure où depuis février 2022 la guerre est revenue sur le continent européen, chacun mesure que l’Union européenne nous a apporté la paix depuis plus de 70 ans. De même, l’Union européenne apporte à nos pays une masse critique qui nous permet de peser davantage sur la scène internationale, pour y promouvoir nos intérêts dans le respect de nos valeurs communes.
Pour autant, le rappel de ces bénéfices majeurs n’est pas incompatible avec la démarche visant à optimiser la performance française en matière de fonds européens.
C’est pourquoi, afin d’amplifier nos résultats, le Gouvernement a récemment mis en place une stratégie renouvelée de mobilisation des fonds européens, qui fait l’objet d’une coordination par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), service placé sous l’autorité du Premier ministre.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés d’ores et déjà.
a/ Fonds en gestion directe
- Un diagnostic précis, réalisé sur l’ensemble des près de 40 fonds européens existants (Horizon Europe, Life+, etc.), montre qu’une meilleure mobilisation des fonds en gestion directe permettrait à la France de recevoir au moins 1,5 milliard d’euros en plus chaque année.
- Cette meilleure mobilisation suppose de remporter davantage d’appels à projets lancés par la Commission européenne, ce qui implique un effort renforcé des ministères qui ont la charge du suivi et de l’animation de ces différents fonds.
A cet égard, les meilleures pratiques observées chez certains groupes industriels ou auprès de centres de recherche publics (notamment la mise en place de cellules dédiées à la captation des fonds européens) pourraient utilement être généralisées et reproduites au sein de nombreux opérateurs de l’État et dans des écosystèmes moins organisés. Le renforcement de la fonction de tutelle exercée par les ministères y contribuera, avec une meilleure prise en compte des gisements mobilisables au niveau européen dans la fixation des subventions annuelles versées par l’Etat par exemple.
- Le diagnostic réalisé a également souligné le besoin d’une approche interministérielle renforcée, en particulier s’agissant des fonds qui concernent de très nombreuses politiques publiques, à l’instar du programme européen de la recherche « Horizon Europe » (santé, énergie, alimentation, sécurité, numérique, transport, etc.).
Dans ce contexte, une expérimentation visant à mobiliser, en lien avec le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, le réseau de BPI France en vue d’accompagner les entreprises (en particulier au sein du tissu des ETI et des PME) et des centres de recherche susceptibles de porter des projets est lancée ce mois-ci pour une durée de deux ans.
Enfin, le Premier ministre a confié à la Délégation interministérielle de la transformation publique (DITP) une mission visant à optimiser l’organisation de l’État pour mieux mobiliser les fonds européens.
b/ Fonds en gestion partagée
Des marges de progression sont également identifiées dans la mobilisation des fonds en gestion partagée, qui sont pré-alloués aux Etats membres (enveloppes nationales). La France en bénéficie fortement à travers la politique agricole commune, la politique de la cohésion (FEDER et FSE), les affaires maritimes et la pêche et les fonds relevant des affaires intérieures (sécurité, frontières, migrations). Leur montant représente près des deux tiers des fonds européens. Sur les 80 milliards d’euros que touche la France au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, 15 milliards d’euros sont gérés directement par les conseils régionaux, en charge de la politique de cohésion et responsables des autres fonds en gestion partagée, comme les affaires maritimes et la pêche et le développement rural.
La bonne consommation des enveloppes pré-allouées est primordiale, ce qui suppose de simplifier autant que possible les démarches pour les porteurs de projets et de garantir des délais de paiement raisonnables.
Il s’agit d’un objectif partagé par l’État comme par les régions de l’Hexagone et des Outre-mer.
Le Gouvernement publiera régulièrement les résultats de cette mobilisation, par fonds et par ministère. Cela doit permettre d’accroître davantage encore les bénéfices concrets que nos concitoyens sont en droit d’attendre de l’Union européenne mais aussi de mieux communiquer auprès d’eux sur les bénéfices tirés de l’appartenance à l’Union européenne.
BILAN DU PERMIS DE CONDUIRE À 17 ANS
Le ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur, a présenté une communication relative au bilan du permis de conduire à 17 ans.
L’accès aux mobilités est un enjeu essentiel pour les jeunes.
La mesure d’abaissement à 17 ans de l’âge pour obtenir le permis de conduire a été annoncée en juin 2023 en conclusion des « Rencontres jeunesse de Matignon » organisées dans le cadre du Conseil national de la Refondation (CNR) dédié à la jeunesse, après une très large consultation des associations et des professionnels de l’éducation routière.
Cette décision s’est traduite par un décret en conseil d’Etat en date du 21 décembre 2023, autorisant l’obtention du permis B à l’âge de 17 ans à partir du 1er janvier 2024.
Le bilan après un an montre que les jeunes de 17 ans se sont pleinement emparés de la mesure :
- 290 050 jeunes de 17 ans ont passé l’examen pratique en 2024, soit 33,7 % de cette classe d’âge ;
- 211 471 jeunes de 17 ans ont obtenu le permis de conduire en 2024 ;
- signe de la motivation et des capacités d’apprentissage des jeunes apprenants, le taux de réussite atteint près de 73 % chez les jeunes de 17 ans, contre 58,35 % tous âges confondus.
La progression des inscriptions concerne la quasi-totalité des départements, sans différenciation nette entre les zones rurales et urbaines. Le succès est notable sur la petite couronne parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis mais aussi dans les départements d’outre-mer.
L’abaissement de l’âge du permis à 17 ans a conduit à une baisse des inscriptions à la conduite accompagnée pour les jeunes de 16 et de 17 ans, et d’une hausse de ces inscriptions pour les jeunes de 15 ans (+8 %). Le maintien de l’attractivité de ce mode d’apprentissage est un enjeu important : grâce à une expérience de conduite longue et variée, la conduite accompagnée offre un taux de réussite supérieur à 78 %.
Le chiffre provisoire des accidents de la route en 2024 démontre que les jeunes conducteurs de 17 ans n’ont pas un taux d’accident plus élevé que les autres groupes d'âge. La répercussion de cette réforme sur les résultats d’accidentalité des jeunes conducteurs de 17 ans sera mesurée au début de l’année 2026.
MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL
Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative :
- Mme Dominique MARCHAND, administratrice de l’Etat, est nommée cheffe du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
Sur proposition de la ministre de la culture :
- il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale adjointe au ministère de la culture exercées par Mme Aude ACCARY-BONNERY, à compter du 3 mars 2025.
Sur proposition du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
- M. Jérôme BONNAFONT, administrateur de l’État, est nommé ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente française près les Nations unies à New-York, à compter du 1er mars 2025.