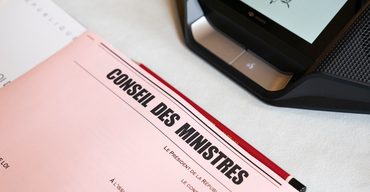ORDONNANCES
- Réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Extension et adaptation en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie des dispositions de la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
DECRETS
- Liste des personnes habilitées à inspecter les établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés
- La sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel dans le code de la construction et de l’habitation et modification de certaines procédures d’instruction
COMMUNICATION
- Relations entre l’Union européenne et le Mercosur
MESURES D'ORDRE INVIDIVUEL
Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 19 novembre 2025 :
19 novembre 2025
Compte rendu du Conseil des ministres du 19 novembre 2025.
ORDONNANCES
REECRITURE DU CODE DE PROCEDURE PENALE (PARTIE LEGISLATIVE)
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), que le Gouvernement avait été habilité à prendre par la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Réalisée à droit constant, sans modifier les règles de fond de la procédure pénale, cette réécriture procède à une très importante clarification du plan du code et à une simplification de plusieurs de ses dispositions, dont l’appréhension par les forces de l’ordre comme les magistrats était particulièrement complexe en raison des modifications successives du code depuis sa création en 1958.
Cette réécriture était réclamée par l’ensemble des acteurs du monde judiciaire comme par les justiciables, les États généraux de la justice ayant officiellement reconnu le caractère illisible du code actuel et son absence de cohérence.
Outre un titre préliminaire, le texte du nouveau code de procédure pénale comportera les 8 parties suivantes, divisées elles-mêmes en livres, titres et chapitres :
- Dispositions générales ;
- Acteurs de la procédure ;
- Investigations et mesures de sûreté pré- sentencielles ;
- Réponses pénales ;
- Procédures d’exécution et d’application des peines
- Procédures particulières ;
- Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
- Dispositions relatives à l’outre-mer.
Ce nouveau code suit donc un plan cohérent, à la fois thématique, en regroupant des dispositions transversales applicables aux différentes étapes de la procédure, et chronologique, en suivant le déroulement habituel d’une procédure pénale. Ses dispositions sont présentées dans des articles plus courts et dont la rédaction a été conçue pour éviter les répétitions et les renvois, afin d’en faciliter la lecture.
L’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale pourra être reportée, via le projet de loi de ratification ou un vecteur législatif à venir, jusqu’au 1er janvier 2030, afin de faciliter son appropriation par les acteurs judiciaires et de procéder aux importantes adaptations informatiques que sa mise en œuvre rend nécessaire. Par ailleurs, des simplifications au fond des procédures, attendues en particulier par la filière judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, seront proposées par le Gouvernement et portées dans un vecteur législatif spécifique, ainsi que le Beauvau de la sécurité en a confirmé la nécessité.
Un projet de loi de ratification sera déposé dans les six mois suivant la publication de cette ordonnance.
EXTENSION ET ADAPTATION EN POLYNESIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE CALEDONIE DES DISPOSITIONS DE LA LOI VISANT A HARMONISER LE MODE DE SCRUTIN AUX ELECTIONS MUNICIPALES AFIN DE GARANTIR LA VITALITE DEMOCRATIQUE, LA COHESION MUNICIPALE ET LA PARITE
La ministre des outre-mer a présenté une ordonnance étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie les dispositions de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
L’article 2 de la loi précitée a renvoyé à voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour étendre et adapter ses dispositions en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie.
L’ordonnance présentée a ainsi pour objet principal d’adapter l’entrée en vigueur de la loi dans ces deux territoires, en prévoyant sa mise en œuvre à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, soit en 2032, contrairement au droit commun, où elle s’appliquera dès le renouvellement de 2026.
L’ordonnance procède ainsi à toutes les modifications nécessaires du code électoral, du code général des collectivités territoriales et du code des communes de la Nouvelle Calédonie pour, à compter de 2032, étendre :
- le scrutin de liste proportionnel et paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants en Polynésie française ;
- le principe de parité aux communes de moins de 1 000 habitants en NouvelleCalédonie (celles-ci étaient déjà soumises au scrutin de liste proportionnel) ;
- les dispositions prévoyant que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes peuvent comporter jusqu’à deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir et que les listes et les conseils municipaux sont réputés complets s’ils comportent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu ;
- « l’exception d’incomplétude », prévue pour les communes de 500 à 999 habitants : les conseils municipaux de ces communes seront désormais réputés complets s’ils comportent 13 membres ;
- la mise en place du scrutin de liste paritaire à l’élection des adjoints dans les communes de moins de 1 000 habitants (contre 3 500 habitants actuellement) en Nouvelle Calédonie.
L’ordonnance prévoit également des dispositions de simplification et d’alignement du droit applicable en Nouvelle- Calédonie.
Cette ordonnance vise ainsi à garantir que la loi du 21 mai 2025, véritable avancée pour la parité dans la vie politique locale, soit bien appliquée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Elle permet toutefois d’adapter le calendrier de cette obligation afin de prendre en compte la proximité de l’échéance, les spécificités et les volontés locales.
DECRETS
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A INSPECTER LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE PUBLICS OU PRIVES
Le ministre de l’éducation nationale a présenté un décret élargissant la liste des personnes habilitées à inspecter les établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés.
Le ministère de l’éducation nationale poursuit son engagement en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences physiques, morales et sexuelles commises au sein des établissements scolaires, à l’appui notamment d’un renforcement des contrôles des établissements d’enseignement privés.
Ce texte, qui modifie l’article L. 241-4 du code de l’éducation, introduit une approche pluriprofessionnelle des contrôles en permettant aux inspecteurs relevant du ministère de l’éducation de s’appuyer sur des compétences complémentaires. Il permettra aux recteurs d’académie d’élargir la composition des équipes d’inspection en désignant des agents publics ou en associant des personnes de droit privé, choisis pour leurs compétences et leur expérience dans les domaines faisant l’objet du contrôle.
Ce texte vise ainsi à renforcer les capacités de l’État à identifier et prévenir les situations de maltraitance dans les établissements d’enseignement privés, mais aussi publics, en élargissant les profils des personnes susceptibles de participer aux contrôles. Cet élargissement de la liste des personnes susceptibles de participer aux inspections des établissements concerne en particulier les profils médico-sociaux.
En diversifiant les profils au sein des équipes d’inspection, le ministre entend favoriser la détection de signaux faibles et permettre une meilleure évaluation du climat scolaire, dans une démarche de prévention et de lutte contre les violences commises à l’égard des élèves.
Le décret entrera en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
LA SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL DANS LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ET MODIFICATION DE CERTAINES PROCEDURES D’INSTRUCTION
Le ministre de la ville et du logement a présenté un décret fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l’incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l’habitation et modifiant certaines procédures d’instruction.
Le ministère de l’intérieur, le ministère du travail et des solidarités et le ministère de la ville et du logement, travaillent depuis plusieurs mois aux dispositions nécessaires à la mise en œuvre pérenne des solutions d'effet équivalent dans le domaine de la sécurité contre l’incendie.
Introduites par la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) en 2018, les solutions d’effet équivalent permettent au maître d’ouvrage de s’écarter d’une règle prescriptive de moyens, dès lors qu’il démontre, par une approche fondée sur la performance, que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, soit par comparaison à une solution de référence respectant la réglementation, soit par le respect des objectifs généraux de sécurité énoncés dans le code de la construction et de l’habitation : contribuer à éviter l'éclosion d'un incendie, et, en cas d'incendie, permettre de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et faciliter l'intervention des secours.
L’ensemble des éléments relatifs à ces solutions (études, attestations et conditions de maintenance) seront annexés au registre de sécurité incendie qui consigne de façon obligatoire dans chaque bâtiment les informations indispensables pour assurer la sécurité incendie du bâtiment et de ses occupants.
Afin d’améliorer la lisibilité du droit applicable à la construction, le décret procède également au transfert du code du travail vers le code de la construction et de l’habitation des dispositions réglementaires concernant les règles de sécurité incendie dans les bâtiments à usage professionnel.
Ce décret précise également les règles applicables concernant les demandes d’autorisation de travaux et l’ouverture des établissements recevant du public au titre de la sécurité incendie pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie hors locaux à sommeil.
Il unifie enfin dans une unique section du code de la construction et de l’habitation les procédures d’agrément des laboratoires chargés de procéder aux essais nécessaires pour assurer le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu des produits, éléments de construction et des matériaux d’aménagement utilisés dans la construction des bâtiments, qui seront pilotées par le préfet de police de Paris.
Le décret entrera en vigueur :
- le 1er juillet 2026 pour les dispositions de sécurité incendie communes à tous les bâtiments ;
- le 1er janvier 2027 pour le transfert des dispositions concernant les bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l’habitation.
Ce calendrier progressif permettra aux acteurs de la construction, aux services instructeurs et aux organismes agréés de s’approprier les nouvelles dispositions dans les meilleures conditions.
COMMUNICATION
RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LE MERCOSUR
A la demande du Président de la République et du Premier ministre, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont présenté, à l’ensemble des membres du Gouvernement, une communication sur les relations entre l’Union européenne et les pays du Mercosur.
Ils ont tout d’abord rappelé l’importance des liens d’amitié qui unissent l’Europe et l’Amérique latine et le besoin, dans un monde où l’ordre international et le multilatéralisme sont de plus en plus remis en cause, de forger ensemble des partenariats au service des peuples, d’assurer une diversification des échanges respectueuse de nos intérêts réciproques, comme le récent sommet entre l’Union européenne et la Communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes l’a confirmé.
Pour autant, cela ne saurait conduire à accepter de conclure un accord que nous jugerions contraire à nos intérêts. Dans ce contexte, les deux ministres ont rappelé la position défendue par la France au sujet du projet d’accord liant le Mercosur et l’Union européenne, en discussion depuis 1999. Cette position est la même depuis l’annonce de la finalisation de la négociation par la Commission : l’accord tel qu’il a été conclu par cette dernière à Montevideo en décembre 2024 n’est pas acceptable en l’état.
Le Président de la République, le Premier ministre et les ministres ont, depuis des mois, mobilisé les Etats partageant nos réserves pour obtenir des garanties additionnelles. Nous avons ainsi adopté avec l’Italie, l’Autriche et la Hongrie en juin 2025, puis avec la Pologne en juillet 2025, des déclarations ministérielles conjointes qui ont adressé un message clair à la Commission sur notre position et sur nos attentes.
Dans ce contexte, la France a formulé trois demandes précises répondant chacune à une préoccupation spécifique :
1/ Premièrement, les filières de production agricole européennes doivent être protégées de toute déstabilisation pouvant résulter de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur. En effet, il ne serait pas acceptable que cet accord entraîne des perturbations de marché qui seraient préjudiciables aux produits agricoles sensibles. Il est donc indispensable de disposer d’un mécanisme permettant de répondre aux éventuels déséquilibres de marché et d’éviter les chutes de prix nuisibles aux producteurs européens, en cas d’importation massive de produits agricoles du Mercosur.
C’est dans ce contexte que la Commission a proposé en octobre dernier un dispositif prenant la forme d’une clause de sauvegarde spécifique, applicable aux produits agricoles et destinée à compléter l’accord. Concrètement, ce mécanisme reposerait sur trois éléments qui seraient protecteurs pour les filières agricoles françaises et européennes : (i) une surveillance fine des marchés par la Commission, non seulement à l’échelle de l’Union européenne dans son ensemble mais aussi de chaque Etat membre spécifiquement, pour détecter d’éventuelles perturbations de volume et de prix ; (ii) en cas de suspicion, y compris dans un seul pays, le lancement, sans délai, d’enquêtes formelles de la Commission pour vérifier la réalité desdites perturbations de marché tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union européenne ; (iii) en cas de confirmation de cette réalité, l’adoption très rapide de mesures de sauvegardes, provisoires puis définitives, permettant de bloquer les importations qui bénéficient de l’accord.
Cette proposition constitue un élément nouveau, qui montre que les préoccupations de la France et de ses partenaires sont entendues. La France s’attache en ce moment à s’assurer de la pleine opérationnalité du dispositif afin qu’il soit robuste et activable facilement et permette ainsi une protection effective des filières agricoles nationales. Elle demande que, sur cette base, la proposition de la Commission soit adoptée sans délais au Conseil et au Parlement européen.
Cette avancée est nécessaire mais pas suffisante.
2/ Deuxièmement, les produits importés doivent impérativement respecter les normes imposées aux producteurs européens pour des raisons environnementales ou liées à la santé humaine. C’est du bon sens autant qu’une exigence d’équité. Du bon sens parce que, si par exemple un pesticide ou un additif alimentaire sont interdits en Europe à cause de leurs conséquences négatives pour l’environnement ou la santé, ils doivent l’être logiquement pour tout produit qui entre sur le marché intérieur, et ce d’où qu’il vienne. C’est aussi une exigence d’équité car, si les agriculteurs européens sont les seuls à se voir imposer ces règles, ils subiront alors une concurrence déloyale de la part de leurs homologues étrangers. C’est pourquoi les agriculteurs demandent à raison que l’Union européenne traite enfin ce sujet majeur.
En conséquence, la France demande à la Commission européenne de présenter dans les plus brefs délais des propositions d’actes réglementaires sur des « mesures miroirs » relatifs aux pesticides et à l’alimentation animale, permettant de garantir l’application réciproque des normes à tous les produits agricoles, dès lors qu’ils entrent sur le marché intérieur. C’est impératif et urgent.
3/ Enfin, troisièmement, l’application des règles européennes aux produits qui entrent sur le marché européen court le risque de rester purement virtuelle si ne sont pas mis en place en même temps des mécanismes de contrôle sanitaire et de vérification robustes. C’est pourquoi il importe que les contrôles sanitaires et phytosanitaires à la fois sur les produits importés, à leur arrivée aux frontières de l’Union européenne, et dans les pays exportateurs, par des audits sur place, soient considérablement renforcés. La France attend ainsi de la Commission la présentation rapide d’un plan d’actions détaillé et des projets d’actes associés, avant la mise en place d’une « force de contrôle sanitaire », comme le Président de la République en a formulé la demande à plusieurs reprises.
C’est à l’aune des résultats obtenus sur ces trois préoccupations majeures que la France arrêtera sa position définitive sur le projet d’accord entre l’Union européenne et le Mercosur.
Le maintien du statut de grande puissance agricole de notre pays est une priorité stratégique. La France défendra donc très fermement ses intérêts agricoles, dans le cadre du projet d’accord avec le Mercosur, mais aussi dans le cadre de la prochaine Politique Agricole Commune (PAC), en cours de négociation avec la proposition de prochain cadre financier pluriannuel de l’UE pour 2028-2034. A ce titre, elle sera très attentive à ce que les moyens accordés soient à la hauteur des ambitions, refusant toute baisse des crédits alloués à la France au titre de la PAC sur la prochaine programmation, et refusera toute volonté de renationalisation de cette politique européenne essentielle, afin de préserver le caractère de politique véritablement commune de la PAC. L’enjeu de préservation des conditions de concurrence loyale et de compétitivité pour nos filières agricoles continuera d’être défendu au-delà de l’accord avec le Mercosur, notamment s’agissant des mesures liées à la disponibilité d’engrais abordables et à la protection contre les fuites de carbone.
MESURES D'ORDRE INDIVIDUEL
Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition du ministre de l’intérieur :
- Mme Estelle BALIT, contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, est nommée déléguée interministérielle à la sécurité routière et déléguée à la sécurité routière au ministère de l’intérieur ;
- M. Charles MOREAU, inspecteur général de l'administration, est nommé chef du service de l’inspection générale de l’administration, à compter du 15 décembre 2025 ;
- M. Jacques WITKOWSKI, administrateur de l’État, est nommé préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
- M. Amaury de SAINT-QUENTIN, administrateur de l’État, est nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du BasRhin ;
- M. Franck ROBINE, administrateur de l’État, est nommé préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Illeet-Vilaine.
Sur proposition de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de la ministre de l’action et des comptes publics :
- M. Laurent GALLET, administrateur de l’État, est nommé, pour un nouveau mandat, directeur de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM).
Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et de la ministre de l’action et des comptes publics :
- Mme Aurélie LAPIDUS, inspectrice générale des finances, est nommée secrétaire générale des ministères économiques et financiers.
Sur proposition du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
- M. Damien COMBREDET-BLASSEL est nommé ambassadeur pour le sport.
Sur proposition de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace :
- M. Didier SAMUEL est maintenu dans ses fonctions de président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, jusqu’au 31 janvier 2027.