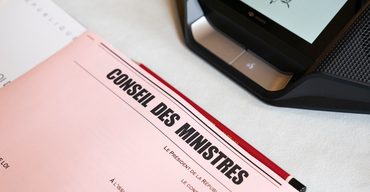PROJETS DE LOI
- Loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République
- Régulation de l’enseignement supérieur privé
- Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
- Restitution de biens culturels
DECRET
- Pouvoirs des préfets, organisation et action des services de l’Etat dans les régions et départements
COMMUNICATION
- L’action territoriale de l’Etat
MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL
Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 30 juillet 2025 :
30 juillet 2025
Compte rendu du Conseil des ministres du 30 juillet 2025.
PROJETS DE LOI
LOI CONSTITUTIONNELLE POUR UNE CORSE AUTONOME AU SEIN DE LA REPUBLIQUE
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a présenté un projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République.
A l’occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la Libération de la Corse, le Président de la République s’est exprimé le 28 septembre 2023 devant l’Assemblée de Corse sur l’avenir de l’île au sein de la République. Il a manifesté le souhait que soit tenue en Corse la promesse républicaine, en particulier la sécurité de nos concitoyens, en redonnant confiance à la société corse, à sa jeunesse, et en relançant vigoureusement le développement de l’île. Il a estimé que, pour cela, la Corse, enracinée dans la France et dans la République, avait besoin aujourd’hui de davantage de liberté, de reconnaissance de son identité, de sa singularité insulaire et méditerranéenne. Il a souhaité que cette singularité puisse être reconnue et trouver sa place au sein de notre Constitution.
A cette fin et en application du premier alinéa de l’article 89 de la Constitution, le Premier ministre a proposé au Président de la République le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, examiné aujourd’hui en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Depuis plusieurs années, et en particulier à la suite de plusieurs élections qui s’y sont tenues, la Collectivité de Corse souhaite bénéficier d’un statut d’autonomie actant sa singularité. En ce sens, la Corse est un territoire dont les spécificités ont des incidences concrètes quotidiennes.
Partant, pour répondre à cette aspiration et rendre possibles la conception et l’adoption d’un cadre juridique prenant en compte les spécificités et intérêts propres de la Corse, la création d’un nouvel article de la Constitution est nécessaire.
L’élaboration de ce projet de loi constitutionnelle s’est faite avec les élus de Corse dans le cadre de négociations politiques qui ont abouti à un accord en mars 2024 sur des écritures constitutionnelles. Le Gouvernement a consulté la collectivité de Corse le 26 mars 2024 sur ce texte. L’Assemblée de Corse a exprimé son adhésion à ces écritures et à ce processus politique inédit à la quasi-unanimité de ses membres. C’est ce texte qui a été présenté en conseil des ministres.
Le présent projet de loi constitutionnelle comporte une disposition unique, insérant au sein du titre XII de la Constitution, un nouvel article 72-5. Ce nouvel article de la Constitution est composé de six alinéas.
Ce projet de loi constitutionnelle reconnaît un statut d’autonomie à la collectivité de Corse et les spécificités de la Corse.
Ces spécificités seront de nature à justifier que les normes applicables en Corse puissent différer du reste du territoire. Ce statut d’autonomie se caractérisera par l’octroi de pouvoirs normatifs d’adaptation et d’édiction des normes, pour que la collectivité de Corse puisse adapter ou fixer les normes en prenant en compte ses spécificités sans méconnaître ni les autres principes constitutionnels, parmi lesquels la souveraineté nationale et l’indivisibilité de la République et le fait que la langue de la République est le français, ni le droit de l’Union européenne.
Forte de ce nouveau pouvoir normatif, la collectivité de Corse ne pourra cependant pas intervenir dans les domaines régaliens relevant de l’Etat, ni dans les domaines relevant des communes. De même l’adaptation ou la fixation de normes qui lui sont propres ne pourront intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Le projet de loi constitutionnelle précise également les modalités de contrôle de ces nouveaux pouvoirs, avec l’intervention du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, en renvoyant à une loi organique le soin de fixer les conditions dans lesquelles seront exercées ces nouvelles compétences normatives et leur champ d’intervention.
Enfin, ce projet de loi constitutionnelle peut permettre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, sur le projet de statut de la Corse fixant les pouvoirs normatifs défini par la loi organique après avis de l’Assemblée de Corse.
Avancée majeure pour la reconnaissance des spécificités de la Corse, fruit d’un processus politique inédit, ce projet de loi constitutionnelle la fait bénéficier d’un régime d’autonomie propre, conforme à sa singularité d’île méditerranéenne, au sein de la République.
REGULATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
La ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont présenté un projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé.
Le renforcement de notre système d’enseignement supérieur passe par une régulation plus efficace et une modernisation adaptée aux défis contemporains. Nous devons former davantage, notamment dans les filières scientifiques, d’ingénieurs, de techniciens, donner davantage de place aux femmes dans ces formations et mieux adapter notre appareil de formation aux besoins de l’économie. Ces chantiers sont essentiels.
Dans ce contexte, la croissance spectaculaire du secteur privé dans l’enseignement supérieur a profondément transformé le paysage de la formation. Cette évolution, si elle peut répondre à une demande légitime, s’accompagne de dérives préoccupantes qui appellent une réponse de l’Etat. Elle a révélé l’urgence de mieux encadrer un secteur en pleine expansion, où coexistent formations d’excellence et simples officines commerciales, créant une confusion préjudiciable aux étudiants et à leurs familles. Elle a également mis en lumière la nécessité de moderniser notre système public, en lui donnant davantage de liberté pour s’adapter aux besoins des acteurs socio-économiques et des territoires comme aux attentes des étudiants.
Les travaux conduits depuis 2022 – mission direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) - inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), rapport des parlementaires Béatrice Descamps et Estelle Folest, note du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’IGESR – ont établi un diagnostic convergent sur les dérives du secteur privé et la nécessité d’y répondre rapidement.
Dans ce contexte, le projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé traduit un choix assumé : réguler par l’évaluation pour en garantir la qualité, avec un effort de transparence appuyé sur l’expertise de l’Etat, afin de restaurer la confiance de tous vis-à-vis de l’offre de formation dans l’enseignement supérieur.
Ce projet de loi a été bâti sous l’égide du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en étroite collaboration avec plusieurs ministères, dont le ministère chargé du travail et de l’emploi et le ministère chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de travail amorcé par le plan qualité et lutte contre la fraude dans la formation professionnelle présenté par le Gouvernement le jeudi 24 juillet.
Ce projet de loi renouvelle la relation avec les établissements privés, en mettant en place un système cohérent organisé en deux niveaux de reconnaissance par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR).
Le premier niveau comprend les acteurs qui participent au service public de l’enseignement supérieur aux côtés des universités et des établissements publics : les établissements d’enseignements supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), auquel vient s’ajouter un nouveau dispositif de partenariat, délivré par le MESR après une évaluation par le HCERES attestant de la non-lucrativité, de la stratégie d’établissement, de la politique de formation, de l’adossement à une politique de recherche et de l’organisation de la stratégie de vie étudiante.
Le second niveau de reconnaissance prend la forme d’un dispositif d’agrément délivré par le MESR pour les établissements privés qui demandent une reconnaissance sans exercer l’ensemble des missions de l’enseignement supérieur public. Comme pour les partenaires, cette reconnaissance sera précédée d’une évaluation par le HCERES, avec le même niveau d’exigence de qualité sur la stratégie d’établissement et la formation. Une attention particulière sera portée à l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants.
À terme, seuls les établissements partenaires ou agréés :
- pourront porter une formation reconnue par le MESR (via un diplôme visé ou conférant grade) ;
- seront autorisés à figurer sur Parcoursup, d’ici la rentrée 2030, avec une période transitoire qui débutera en 2027.
Ce projet de loi harmonise également par le haut les procédures existantes d’ouverture et de fermeture des établissements d’enseignement supérieur privés. Les régimes juridiques applicables aux cours et aux établissements sont ainsi unifiés et les motifs d’opposition des autorités compétentes sont clarifiés.
Le système est ainsi hiérarchisé. L’ouverture d’un établissement privé reste libre, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi. L’ouverture d’un établissement privé n’implique pas systématiquement sa reconnaissance par le MESR. La reconnaissance d’un établissement par le ministère n’implique pas une reconnaissance de ses formations, qui suppose des évaluations spécifiques.
L’extension des pouvoirs de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche aux personnes morales qui exercent le contrôle des organismes répond à l’évolution du secteur, marqué par la place croissante de structures financières et de gestion complexes.
Ce projet de reconnaissance graduée est enrichi d’un régime de protection des apprenants, pour lesquels les droits sont considérablement renforcés. Le projet de loi instaure pour les étudiants un droit de rétractation jusqu’à trente jours avant le début de la formation et étend les obligations d’information des établissements. Pour les apprentis, il interdit les frais de réservation et leur garantit le remboursement au prorata en cas de départ anticipé.
L’intégration de la vie étudiante au sein des missions du service public est une manière de prendre acte de l’importance de l’accompagnement global des étudiants par les établissements de l’enseignement supérieur, et d’en permettre une meilleure évaluation.
Ce projet de loi propose une mise en cohérence de la régulation par la qualité dans le champ de la formation professionnelle : l’extension de l’obligation Qualiopi à tous les organismes porteurs d’un titre RNCP (répertoire national des certifications professionnelles), quel qu’en soit le mode de financement, permet de mettre en cohérence notre système de formation. Il n’est plus acceptable qu’une formation soit soumise à des obligations différentes selon son mode de financement, une différence qui se faisait au détriment des apprenants. C’est ainsi une grande partie de l’offre de la formation initiale qui sera pour la première fois soumise à des critères de qualité.
Ces actions coordonnées de nos ministères témoignent d’un engagement collectif pour une meilleure régulation du système de formation, et d’une meilleure efficacité du denier public qui le finance. La mise en cohérence de nos actions permettra d’atteindre les objectifs de la feuille de route du Gouvernement sur l’accessibilité d’une offre de qualité sur tout le territoire, pour tous les publics et l’adaptation de notre appareil de formation aux besoins économiques de manière à favoriser l’emploi des jeunes.
Ce projet de loi porte également diverses mesures qui viennent ajuster les règles applicables à l’enseignement supérieur public, pour plus d’agilité et d’autonomie.
Véritable pas supplémentaire en matière d’autonomie universitaire, l’accréditation globale permet aux universités et aux enseignants-chercheurs de créer ou d’adapter leur offre de formation aux besoins des étudiants et des milieux socio-économiques, sans dépendre de longues procédures d’accréditation, tout en maintenant un cadrage national.
La prorogation des établissements publics expérimentaux (EPE) jusqu’en 2031 permet de répondre au vide juridique qui entourait l’échéance de l’ordonnance de 2018 relative aux EPE, issue de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance (ESSOC). Elle donne un temps supplémentaire d’expérimentation aux EPE créés récemment et octroie un délai pour faire émerger de nouveaux projets d’EPE. Elle offre ainsi des possibilités complémentaires de rapprochement universités-grandes écoles pour accentuer la politique de site réclamée par les chefs d’établissements.
Afin d’inscrire l’organisation du ministère dans une logique d’agilité, la loi renvoie au pouvoir réglementaire la désignation de l’autorité compétente au sein de l’Etat pour nommer certains directeurs d’écoles ou d’instituts.
La réforme de l’École polytechnique permet à cet établissement d’excellence d’avoir une gouvernance renouvelée, en actant de la séparation des rôles entre un directeur général qui détient les pouvoirs exécutifs et un président du conseil d’administration non exécutif issu du monde de l’entreprise. Cette nouvelle structuration aligne l’École polytechnique sur le modèle de gouvernance standard des grandes écoles d’ingénieurs françaises.
Cette réforme constitue un investissement dans l’avenir. Pour les étudiants et leurs familles, elle apporte une lisibilité inédite dans un paysage aujourd’hui confus. Pour les établissements, elle offre un cadre clair et cohérent où chacun pourra se situer selon son projet, ses missions et son niveau d’engagement. Pour les territoires, elle favorise l’émergence d’une offre plus transparente, plus cohérente, mieux adaptée aux besoins locaux et mieux articulée avec l’écosystème existant. Pour notre société, cette réforme renforce la capacité collective à innover et à construire un environnement de l’enseignement supérieur plus structuré, plus agile et plus adapté.
Avec cette réforme, l’enseignement supérieur devient plus transparent et la qualité globale des formations augmente tout en renforçant la confiance de tous les acteurs dans le système.
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE DANS LES OUTRE-MER
Le ministre d'Etat, ministre des outre-mer, a presente un projet de loi de lutte contre la vie chere dans les outre-mer.
Le constat est connu. En 2022 et selon l'Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE), les prix a la consommation sont plus eleves dans les departements d¡¦outre-mer qu'en France hexagonale, avec des ecarts allant de 9 % a La Reunion a 16 % en Guadeloupe. Ces ecarts sont particulierement prononces sur les produits alimentaires, allant de 30 % a Mayotte a pres de 42 % en Guadeloupe. Les collectivites d'outre-mer sont egalement touchees. Plus grave encore, ces differentiels de prix se sont creuses au fil des annees.
Sous l'autorite du Premier ministre, qui l'a acte dans le cadre du comite interministeriel des outre-mer (CIOM) du 10 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre des outre-mer, a elabore un plan complet et structurel de lutte contre la vie chere comprenant :
- une circulaire d'ores et deja adressee aux prefets ;
- trois decrets, renforcant le bouclier qualite-prix (BQP) et les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) ;
- un projet de loi, presente ce jour, qui comprend 16 articles repartis en 4 titres :
- le titre Ier vise a agir pour le pouvoir d¡¦achat et compenser les effets de l'éloignement. Il exclut le prix de transport du seuil de revente a perte pour permettre des baisses de prix importantes et rapides (article 1er) ; renforce le BQP, en l¡¦elargissant aux services et en creant des sanctions pour les acteurs qui ne respecteraient pas l'accord qu'ils ont signe (article 2) ; crée, à titre experimental, en Martinique, un e-hub logistique pour faciliter le e-commerce (article 4) ; ou encore permet de mettre en oeuvre un mecanisme de compensation des frais d'approche (article 5) ;
- le titre II vise a ameliorer la transparence en renforcant les obligations des grandes entreprises de la distribution en matiere de transmission des donnees de caisse ou d'information sur les marges arriere, afin de faciliter les controles (articles 6 et 7). Il renforce egalement les sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matiere de depot de comptes (article 9) ;
- le titre III vise a renforcer la concurrence. Pour ce faire, il ajoute deux membres supplementaires au college de l'Autorite de la concurrence, qui seront choisis en raison de leur expertise ultramarine, cree un service d'instruction dedie au sein de l'Autorite, et abaisse le seuil de notification des operations de concentration dans les territoires ultramarins (article 10) ;
- enfin, le titre IV vise a soutenir le tissu economique, en protegeant davantage la production locale (article 13) et en facilitant l'acces des petites et moyennes entreprises a la commande publique dans les territoires ultramarins (articles 14 et 15).
La lutte contre la vie chere passera aussi par une plus forte inscription des territoires ultramarins dans leur environnement regional et donc notamment par une meilleure adaptation des normes europeennes a leurs realites.
RESTITUTION DE BIENS CULTURELS
La ministre de la culture a présenté un projet de loi permettant la restitution à des Etats de biens culturels, relevant de collections publiques, ayant fait l’objet d’une appropriation illicite.
Après les deux lois-cadres précédentes, celle relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites commises entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 (loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023) et celle relative à la restitution des restes humains (loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023), ce nouveau projet de loi-cadre constitue la troisième et dernière étape d’élaboration d’un dispositif législatif destiné à faciliter le processus de restitution des oeuvres relevant du domaine public. Il se place également dans la continuité des récentes lois permettant la restitution de plusieurs oeuvres au Sénégal, au Bénin et à la Côte d’Ivoire (lois n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 et n° 2025-644 du 16 juillet 2025).
Le projet de loi crée dans le code du patrimoine une dérogation au principe d’inaliénabilité pour les oeuvres qui ont fait l’objet, entre 1815 et 1972, d’une appropriation illicite ; le périmètre géographique retenu pour ce texte est universel : la personne publique aura la faculté de prononcer la sortie du domaine public de ces biens culturels lorsque leur appropriation s’est faite dans des situations de vol, de pillage, de cession ou de libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer. La décision de sortie des collections, réalisée pour opérer la restitution du bien à un Etat qui en a donc été privé, répondra à un objectif de réappropriation par son peuple d’éléments fondamentaux de son patrimoine. Elle ne pourra intervenir que par décret en Conseil d’Etat après avis, le cas échéant, d’une commission scientifique bilatérale.
Afin d’assurer la coordination avec le cadre juridique en vigueur en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, le texte organise, autour d’une date-pivot de césure, le 24 avril 1972, deux régimes successifs de restitution. Le premier, créé par le projet de loi, porte sur la période allant du 10 juin 1815, lendemain de l’Acte final du congrès de Vienne, correspondant au règlement des conquêtes napoléoniennes, au 23 avril 1972. Le second, créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, verra sa portée renforcée : de nature juridictionnelle, il relève de l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970, entrée en vigueur à partir du 24 avril 1972.
De portée géographique universelle, ce projet de loi répond également à la volonté du Président de la République de renouveler les relations de la France avec ses partenaires africains. Ce texte donne ainsi une traduction législative aux engagements pris par le Président de la République dès son discours de Ouagadougou, prononcé le 28 novembre 2017, et qui visait à engager un mouvement de restitutions de biens culturels auprès des Etats du continent africain.
Cet engagement politique en faveur des restitutions de biens culturels ayant fait l’objet d’appropriations illicites a été réaffirmé depuis à plusieurs reprises. Il trouve son aboutissement dans ce projet de loi de qui s’inscrit dans une démarche résolue de réparation, matérielle et symbolique, du lien qui unit les Etats concernés à leur patrimoine et à leur mémoire. Ce projet de loi contribue à la reconnaissance et à l’apaisement des mémoires voulus par le chef de l’Etat depuis 2017.
DECRET
POUVOIRS DES PREFETS, ORGANISATION ET ACTION DES SERVICES DE L’ETAT DANS LES REGIONS ET DEPARTEMENTS
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a présenté un décret modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
Cette réforme s’inscrit dans la continuité des annonces formulées par le Président de la République lors de la conférence managériale du 12 mars 2024 et de la refondation de l’action publique engagée par le Gouvernement au mois de février 2025.
Dans un contexte d’organisation administrative devenue complexe du fait de la multiplication des acteurs et d’une déconcentration restant à accentuer, il s’agit de redonner au préfet toute sa place dans l’Etat local qui ne parlera désormais que d’une seule voix, de renforcer la collégialité de l’ensemble des services et opérateurs de l’Etat et de garantir une meilleure prise en compte des réalités locales, pour répondre aux attentes des élus et des concitoyens.
Concrètement, le texte poursuit deux objectifs : la cohérence d’ensemble de l’action des services de l’Etat et la cohérence territoriale des décisions mises en oeuvre.
Le décret prévoit en effet un renforcement des prérogatives managériales du préfet avec une participation accrue de celui-ci au processus de nomination, de fixation des objectifs et des priorités d’actions et d’évaluation des chefs de services déconcentrés, y compris ceux qui ne sont pas placés sous son autorité. Le préfet sera ainsi conforté dans sa fonction de coordonnateur de l’action territoriale de l’Etat.
Le texte crée également un avis du préfet sur les projets d’évolution de la cartographie des services ouverts au public placés sous l’autorité des finances publiques, de l’éducation nationale et des agences régionales de santé.
Les pouvoirs et les moyens dont dispose le représentant de l’Etat pour assurer la coordination et la collégialité entre services sont confortés. Sa capacité de pilotage stratégique de l’action de l’Etat est également réaffirmée.
Ce texte rénove les relations entre le représentant de l’Etat dans les territoires et les opérateurs de l’Etat (établissements publics comme groupements d’intérêt public). Il sera désormais préalablement consulté ou a minima informé des décisions importantes prises par l’opérateur. Il pourra également demander un réexamen des décisions avec, dans certaines conditions, une suspension de la décision dans l’attente du réexamen.
Enfin, il renforce également les prérogatives du préfet sur la nomination, l’évaluation et la fixation des objectifs des chefs de services territoriaux des établissements publics et groupements d’intérêts public de l’Etat et sur leurs actions territoriales, ceci qu’il en soit le délégué territorial ou non.
COMMUNICATION
L’ACTION TERRITORIALE DE L’ETAT
Le Premier ministre a présenté une communication relative à l’action territoriale de l’Etat.
Dix ans après la révision de la Charte de la déconcentration et cinq ans après la dernière réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, les attentes exprimées par nos concitoyens et les élus locaux restent fortes en termes de proximité, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.
Le Président de la République l’avait rappelé et demandé avec force lors de la Convention des managers du 12 mars 2024.
La dynamique de refondation engagée par le Gouvernement s’appuie sur ce constat : dans bien des domaines, l’action de l’Etat est menée de façon segmentée entre un trop grand nombre d’acteurs. Cette multiplicité génère des incompréhensions et des incohérences. Elle rend également difficile, pour les usagers, associations, entreprises, élus, l’identification des interlocuteurs pertinents.
Un vaste chantier de réforme de l’Etat est engagé et il doit aussi concerner l’action territoriale de l’Etat, portée par le préfet qui, selon la Constitution, est le « représentant de l’Etat et de chacun des membres du Gouvernement » sur le territoire dont il a la charge (article 72). Il convient de leur donner les moyens de jouer pleinement ce rôle.
L’action du préfet est trop souvent gênée par la multiplication des canaux d’intervention de l’Etat – parfois directement depuis Paris. Les liens qu’il entretient avec les services déconcentrés et établissements publics de l’Etat ne garantissent pas suffisamment la cohérence de l’action de l’Etat sur le terrain et l’unicité de sa voix.
Le préfet reste également contraint par la complexité de certaines normes qui ne permettent pas la prise en compte des réalités locales. Son pouvoir de déroger aux normes réglementaires créé en 2020, bien que simplifié en novembre dernier, reste limité et ne concerne que 7 domaines énoncés de façon limitative.
La réforme portée par le Gouvernement vient conforter le rôle confié au préfet comme pilote de l’Etat local. Elle vise à renforcer son positionnement et ses prérogatives dans l’objectif de rendre l’action de l’Etat plus cohérente et plus efficace.
Le premier pan de la réforme vise à conforter la capacité du préfet à incarner l’Etat sur le territoire, ainsi qu’à animer et diriger l’action des services déconcentrés et des établissements publics qui agissent au plan territorial. A cette fin, ses prérogatives managériales seront renforcées :
- le préfet sera désormais associé à la nomination de l’ensemble des chefs de services de l’Etat (à l’exception de ceux nommés en conseil des ministres : recteurs et directeurs généraux des agences régionales de santé, dont il sera toutefois au préalable informé), ainsi que des responsables des établissements publics de l’Etat agissant sur son territoire (hors établissements scolaires, hospitaliers et médico-sociaux) ;
- le préfet procèdera ou contribuera à leur évaluation annuelle (y compris pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et, selon des modalités adaptées à leur statut, à la définition de la feuille de route des recteurs), ainsi qu’à la fixation de leurs objectifs et de la part variable de leur rémunération ;
- le préfet sera désigné comme le délégué territorial des opérateurs de l’Etat agissant au plan local, dès lors que leurs missions présentent une dimension territoriale ; à ce titre, il pourra leur adresser des directives d’action territoriale et leur demander de réexaminer, avec effet suspensif, des projets de décision revêtant un impact local significatif ;
- le préfet sera conforté dans sa position de chef d’orchestre de l’action territoriale de l’Etat, avec la responsabilité d’animer la collégialité de l’ensemble des services et opérateurs de l’Etat au plan local ;
- enfin, ses leviers de pilotage des services seront renforcés, avec de nouvelles facilités de gestion des ressources humaines en matière de recrutement et de mobilités, pour permettre au préfet de mieux adapter la configuration de ses équipes aux priorités d’action territoriale que le Gouvernement et chaque ministre lui assignent.
Le second pan de la réforme vise à renforcer la cohérence territoriale des décisions mises en oeuvre, ce qui exige une plus grande proximité et une meilleure prise en compte des réalités locales. A cette fin, les pouvoirs d’adaptation et de dérogation des préfets seront élargis :
- l’implantation des services publics sera désormais systématiquement soumise à l’avis préalable du préfet, qu’il s’agisse de la carte scolaire, du réseau des finances publiques ou encore de l’offre de soins au plan local ;
- le pouvoir de dérogation des préfets, aujourd’hui limité à sept domaines, sera élargi à l’ensemble de leur champ de compétence, s’agissant des décisions individuelles (non-règlementaires) ;
- la territorialisation des nouveaux appels à projet ouverts aux collectivités locales, aux entreprises et aux associations sera désormais la règle et devra être travaillée en lien avec les opérateurs en charge de ces dispositifs pour que les campagnes soient au maximum lancées, pilotées et suivies par les administrations locales ;
- la fongibilité des subventions publiques de l’Etat sera renforcée sous l’autorité des préfets, pour faciliter le financement de projets d’intérêt local majeur.
D’autres transformations seront engagées dans cet esprit, pour renforcer la cohérence de notre organisation au plan local. Le Premier ministre a décidé de lancer une mission d’évaluation interministérielle sur la situation des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des sports en vue de leur transformation. Le Gouvernement tient à ce que ces services, placés depuis 2020 sous l’autorité des recteurs, voient leurs liens renforcés avec les préfets.
L’ensemble de cette réforme traduit une vision commune avec le Président de la République, et une ambition partagée de confiance au terrain, de proximité et d’efficacité.
Ces orientations vont devenir réalité à travers des modifications substantielles du décret du 29 avril 2004, dont la nouvelle version vient d’être délibérée en Conseil des ministres. Elles conduiront également à l’adoption prochaine de plusieurs autres décrets ainsi qu’à la diffusion d’une circulaire qui présentera l’ensemble du dispositif et sera diffusée aux ministres et aux préfets. Une modification législative sera nécessaire s’agissant des opérateurs.
La réforme que nous conduisons vise un seul objectif : l’efficacité de notre action territoriale de l’Etat pour répondre aux attentes de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire national.
MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL
Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition du Premier ministre :
- M. Renaud LASSUS, administrateur de l’Etat, est nommé conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, à compter du 1er septembre 2025.
Sur proposition du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice :
- M. Thomas LESUEUR, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 25 août 2025.
Sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur :
- M. Alexandre ROCHATTE, contrôleur général des armées, est nommé haut-commissaire de la République en Polynésie française, à compter du 1er septembre 2025 ;
- Mme Muriel NGUYEN, administratrice de l’Etat, est nommée préfète de la Loire, à compter du 1er septembre 2025 ;
- M. Thierry DEVIMEUX, administrateur de l’Etat, est nommé préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, à compter du 1er septembre 2025 ;
- Mme Marie-Aimée GASPARI, conseillère référendaire à la Cour des comptes, est nommée préfète de la Drôme, à compter du 1er septembre 2025 ;
- Mme Nadège BAPTISTA, administrateur de l’Etat, est nommée préfète de la Mayenne, à compter du 1er septembre 2025 ;
- M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet des Hauts-de-Seine, à compter du 1er septembre 2025 ;
- M. Eric SPITZ, administrateur de l’Etat, est nommé vice-président du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, à compter du 1er septembre 2025.
2.- Sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur :
- M. le général de division Frédéric BOUDIER est nommé commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est et est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 1er septembre 2025 ;
- Mme la générale de division Florence GUILLAUME est nommée commandante de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est et est élevée aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 1er septembre 2025.
En outre, ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de la gendarmerie.
Sur proposition de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles :
- Mme Véronique SOLERE, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire, est nommée directrice générale de l'agence régionale de santé de Bretagne, à compter du 25 août 2025 ;
- Mme Mathilde MARMIER, médecin de santé publique, est nommée directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. Thomas WANECQ, inspecteur général des affaires sociales, est nommé directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, à compter du 4 août 2025.
Sur proposition du ministre des armées :
- M. le général de corps d’armée Thierry LAVAL est nommé inspecteur général des armées et est élevé aux rang et appellation de général d’armée, à compter du 1er août 2025 ;
- M. le vice-amiral d’escadre Eric JANICOT est nommé inspecteur général des armées et est élevé aux rang et appellation d’amiral, à compter du 1er août 2025 ;
- M. le vice-amiral d’escadre François-Xavier POLDERMAN est nommé major général des armées et est élevé aux rang et appellation d’amiral, à compter du 1er septembre 2025 ;
3.- Sur proposition du ministre des armées :
- M. le vice-amiral d’escadre Alban LAPOINTE est nommé major général de la marine, à compter du 1er septembre 2025 ;
- M. le général de corps aérien du corps des officiers de l’air Laurent RATAUD est nommé inspecteur général des armées et est élevé aux rang et appellation de général d’armée aérienne, à compter du 1er août 2025 ;
- M. le vice-amiral Serge BORDARIER est nommé directeur du personnel de la marine et est élevé aux rang et appellation de vice-amiral d’escadre, à compter du 1er août 2025 ;
- M. le général de division aérienne du corps des officiers de l’air Géraud LABORIE est nommé commandant supérieur des forces armées en Guyane et commandant de la base de défense de Guyane, à compter du 1er août 2025 ;
En outre, ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air et de l’espace.
Sur proposition du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
- Mme Ahlem GHARBI, administratrice de l’Etat, est nommée ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture à Paris ;
- M. Cyrille PIERRE, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques.