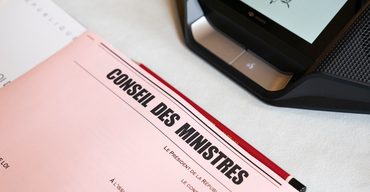COMMUNICATIONS
-
La lutte contre l’antisémitisme en France
-
Point d’étape sur les mesures de soutien à l’agriculture et la souveraineté alimentaire
MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL
Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 19 février 2025 :
19 février 2025 - Seul le prononcé fait foi
Compte rendu du Conseil des ministres du 19 février 2025.
COMMUNICATIONS
LA LUTTE CONTRE L’ANTISEMITISME EN FRANCE
Le Premier ministre et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont présenté une communication sur la lutte contre l’antisémitisme en France.
Depuis les massacres terroristes du 7 octobre en Israël qui ont coûté la vie à plus de 1200 personnes dont 42 Français – auxquels la République a rendu hommage lors de la cérémonie tenue par le Président de la République le 7 février 2024 – l’antisémitisme connait une importante recrudescence. Bien plus qu’un regain, c’est un risque de ré-enracinement qui menace l’ensemble de notre société.
En 2022, la France recensait 436 actes antisémites. En 2023, ce sont 1 676 actes qui étaient commis, dans 95 départements sur 101, et ce, en dépit de la grande réactivité de l’Etat au travers notamment de la circulaire du ministère de la justice émise dès le 10 octobre 2023 appelant à une réponse pénale ferme et rapide face à l’antisémitisme et à l’apologie du terrorisme, et à la mobilisation des préfets, des services de police et de gendarmerie, et des magistrats.
Cette tendance s’est confirmée en 2024, avec 1570 actes antisémites, marquant un nouveau palier qui se maintient mois après mois. Les actes antisémites représentent aujourd’hui 62% de l’ensemble des faits antireligieux. Tous les trois jours, un Français juif est victime d’une agression physique.
Les actes dirigés contre les lieux de culte et cimetières israélites sont également en augmentation de 11 % en 2024.
Par ailleurs, le risque de creusement d’un fossé générationnel apparait. Les auteurs d’actes antisémites sont de plus en plus jeunes : 42 % des mis en cause pour des faits d’antisémitisme ont moins de 35 ans, et les faits au sein des établissements d’enseignement supérieur se multiplient.
Parmi les plus jeunes, les discours de haine tendent à se banaliser. Ils sont plus enclins à partager des préjugés antisémites que le reste de la population : près d’un quart des moins de 35 ans juge « acceptable » ou « compréhensible » le fait de taguer une synagogue ou un commerce supposé juif pour manifester une opposition à Israël. Quelques jours après la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah le 27 janvier dernier, près d’un jeune sur vingt considère que la Shoah est une invention.
Ces actes et leur violence ne sont pas des faits nouveaux. En 2006, Ilan Halimi était assassiné parce que juif. En 2012, à Toulouse, trois enfants et un enseignant étaient assassinés parce que juifs. En 2017, Sarah Halimi était assassinée parce que juive. En 2018, Mireille Knoll, survivante de la Shoah, était assassinée parce que juive.
Derrière chaque Français agressé pour sa judaïcité réelle ou supposée, c’est toute la République qui est mise en cause.
Face à cela, l’Etat, à travers l’action du ministère de l’Intérieur, assure pleinement sa mission de protection. Plus de 800 sites font l’objet de dispositifs de surveillance (police, gendarmerie, militaires de l’opération Sentinelle) depuis le 12 janvier 2015. Ce dispositif est amplifié lors des grandes fêtes religieuses avec des instructions systématiquement données aux préfets.
Le financement de travaux de protection (vidéoprotection et sécurisation) des bâtiments communautaires (principalement les synagogues et les écoles) lancé dès 2004 a été renforcé depuis 2015 avec l’apport des crédits du plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
Malgré les efforts entrepris, la tâche est rendue plus difficile au quotidien car le risque s’est multiplié et dilué en touchant non seulement des lieux exposés comme les écoles et les synagogues, mais aussi des établissements commerciaux, voire même le domicile des victimes.
Au-delà, depuis 2017, le Président de la République a marqué l’engagement de la France dans la lutte contre l’antisémitisme et toutes les haines, notamment en ligne. L’Etat met en œuvre d’ambitieux plans nationaux pour endiguer ces fléaux dans le cadre d’une philosophie universaliste et d’une logique interministérielle.
Le plus récent, le plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (PRADO), lancé le 30 janvier 2023, comporte des actions éducatives et préventives auprès des publics scolaires et étudiants, comme l’obligation d’une visite mémorielle au cours de la scolarité ; des actions de formation des professionnels, et notamment des gendarmes, magistrats, enseignants ; un accompagnement des victimes notamment par la facilitation du dépôt de plainte ; un soutien aux acteurs locaux et nationaux de la lutte contre l’antisémitisme ; des actions pour une meilleure répression des discours de haine, notamment sur internet via la plateforme Pharos. Un comité interministériel de suivi du PRADO se tiendra au printemps.
En dépit d’une mobilisation interministérielle totale, les actes antisémites persistent, si bien qu’il apparait impératif d’engager un nouveau temps d’action publique.
C’est en ce sens que la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a lancé les Assises de lutte contre l’antisémitisme le 13 février dernier, date commémorative du martyre d’Ilan Halimi et jour de la remise du Prix Ilan Halimi par le Président de la République à l’Elysée.
Résolument tournées vers la jeunesse, ces Assises ont permis l’installation de deux groupes de travail.
Le premier, composé de magistrats, d’avocats, de chercheurs, se penchera sur la question de la définition de l’antisémitisme dans ses formes contemporaines et sera chargé de proposer les évolutions nécessaires de notre arsenal juridique et législatif pour garantir une sanction plus efficace de tous les actes et discours haineux.
Le second, consacré à l’éducation, s’inscrira dans une logique de prévention, de formation et de transmission. Il aura pour mission d’identifier les leviers pédagogiques et les actions de responsabilisation indispensables pour éduquer nos enfants, adolescents et jeunes adultes, sensibiliser leurs parents et enseignants, à l’école comme dans l’enseignement supérieur, contre les préjugés, les appels à la division et les actes de haine et de violence, dans tous les territoires de la République.
Ces groupes de travail disposent de deux mois pour formuler au Gouvernement des propositions opérationnelles.
POINT D’ETAPE SUR LES MESURES DE SOUTIEN A L’AGRICULTURE ET LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté une communication faisant un point d’étape sur les mesures de soutien à l’agriculture et la souveraineté alimentaire.
Le salon international de l'agriculture 2025 s’ouvre cette année sous le thème : « l’agriculture, une fierté française ». Depuis plus de 60 ans, cet événement incontournable réunit la France agricole aux portes de Paris, mettant en lumière l'attachement inaltérable des Français à ceux qui nourrissent le pays.
Le salon, cette année, n’est pas un salon comme les autres car il est le premier grand rendez-vous après l’expression de la démocratie agricole et parce qu’il clôture une année très difficile pour la ferme France.
Une année particulièrement éprouvante pour l’agriculture
L’année 2024 a été marquée par une série de catastrophes naturelles, allant du cyclone qui a frappé Mayotte aux désordres climatiques affectant toute la France : pénurie d'eau, inondations, manque d'ensoleillement. Les épidémies animales ont, en outre, lourdement affecté les élevages partout en France. Ces phénomènes ont lourdement impacté la production agricole, affectant les cheptels, les cultures et les trésoreries des agriculteurs. Ces crises ont également mis à mal le moral des paysans et de tous les acteurs des filières agricoles.
Face à cette situation alarmante, et en dépit d’un des contextes politique et budgétaire les plus difficiles sous la Vème République, l’État a honoré tous les engagements pris depuis un an face au désarroi agricole et a rapidement mis en œuvre de nouvelles mesures d’urgence pour venir en aide aux exploitants frappés par des épizooties ou la chute des rendements. Après un an de concertation, des mesures fiscales, financières et sociales ont été mises en place pour soutenir l’agriculture face aux difficultés.
Des engagements tenus
Avec l’adoption du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), l’Etat honore la promesse d’allègements de charges fiscales et sociales à hauteur de 500 millions d’euros au bénéfice des agriculteurs. Depuis 6 mois, le Gouvernement a également déployé des mesures d’urgence face aux crises sectorielles, notamment :
- L’arrachage des vignes pour un montant de 110 millions d’euros, en réponse à la gestion du potentiel de production viticole ;
- Soutien aux trésoreries fragilisées, avec des prêts conjoncturels bonifiés par l’État ;
- Prêts de consolidation garantis par l’État à hauteur de 70% pour les exploitations structurées par des aléas climatiques ;
- Pour les secteurs touchés par les épizooties (ovins, bovins, aviculture), des mesures sanitaires et économiques ont été mises en place, dont la prise en charge de 120 millions de doses vaccinales pour les éleveurs et une indemnisation des pertes à hauteur de 75 millions d'euros.
Face aux enjeux du changement climatique, le Plan Méditerranée Climat a été lancé cet automne avec une dotation de 50 millions d’euros et le « fonds hydraulique » a permis de financer 48 projets en 2024 pour améliorer l’accès à l’eau des agriculteurs, à hauteur de 20 millions d’euros.
En créant les « Rendez-vous mensuels de la simplification », le ministère chargé de l’agriculture s’est mobilisé pour simplifier la vie des agriculteurs en réduisant le fardeau administratif et la superposition des normes qui sont autant d’obstacles à la compétitivité des entreprises, agricoles et agro- alimentaires. Avec la mise en place du contrôle administratif unique en octobre dernier, le Gouvernement a répondu de manière opérationnelle à une demande forte de la profession. Enfin, l’examen du projet de loi pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture au Parlement pourrait s’achever dans les prochains jours, en cas d’accord entre députés et sénateurs sur un texte commun.
Le salon du rebond
Dans un contexte de changement climatique, de bouleversement géopolitique et d’investissement massif des grandes puissances dans l’alimentation, la France doit réaffirmer sa souveraineté agricole et réarmer sa puissance alimentaire. Dans ce souci d’une meilleure appréhension de la géopolitique agricole, la France se réjouit de la décision du Salon International de l’Agriculture d’avoir souhaité faire du Maroc l’invité d’honneur de ce salon.
Ce 61ème salon de l'agriculture doit être le début d’une volonté résolue de reconquête. C’est aussi le sens de la ferme opposition de la France au projet d’accord du MERCOSUR et c’est aussi le sens des priorités que la France défendra dans les discussions qui s’ouvrent sur l’avenir de la PAC après 2027.
Le pays doit se mobiliser pour garantir aux agriculteurs l’accès aux moyens de production indispensables à l’heure du changement climatique, reconquérir l’assiette des Français et continuer d’affirmer sa place dans le commerce alimentaire mondial.
C’est un enjeu régalien qui appelle un nouveau Pacte social entre la Nation et ses agriculteurs, que le Gouvernement veut sceller en 2025.
MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL
Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :
- M. Jean-Luc MOULLET, ingénieur général des mines, est nommé directeur général de la recherche et de l'innovation.
Sur proposition du ministre d’État, ministre de l’intérieur :
- M. Stéphane HARDOUIN, magistrat, est nommé directeur des services actifs de la police nationale, chef de l'inspection générale de la police nationale, à compter du 28 février 2025.
En outre, a été adoptée une mesure diverse d’ordre individuel concernant un officier général de la gendarmerie nationale.
Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :
- M. Philippe PASCAL, inspecteur général des finances, est nommé président directeur général de la société Aéroports de Paris.
Sur proposition du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
- M. Romaric ROIGNAN, conseiller des affaires étrangères, est nommé directeur d’Afrique du Nord et Moyen Orient à l’administration centrale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, à compter du 20 mars 2025 ;
- M. Jean-Pierre ASVAZADOURIAN, administrateur de l’État, est nommé ambassadeur, secrétaire général de la Présidence française du G7.
À consulter également
Voir tous les articles et dossiers-
3 février 2026 Déplacement en Haute-Saône.

-
5 février 2026 Réception en amont du départ de l’astronaute française Sophie Adenot vers la station spatiale internationale.

-
8 janvier 2026 La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur.

-
16 décembre 2025 Face aux lecteurs de La Provence à Marseille.